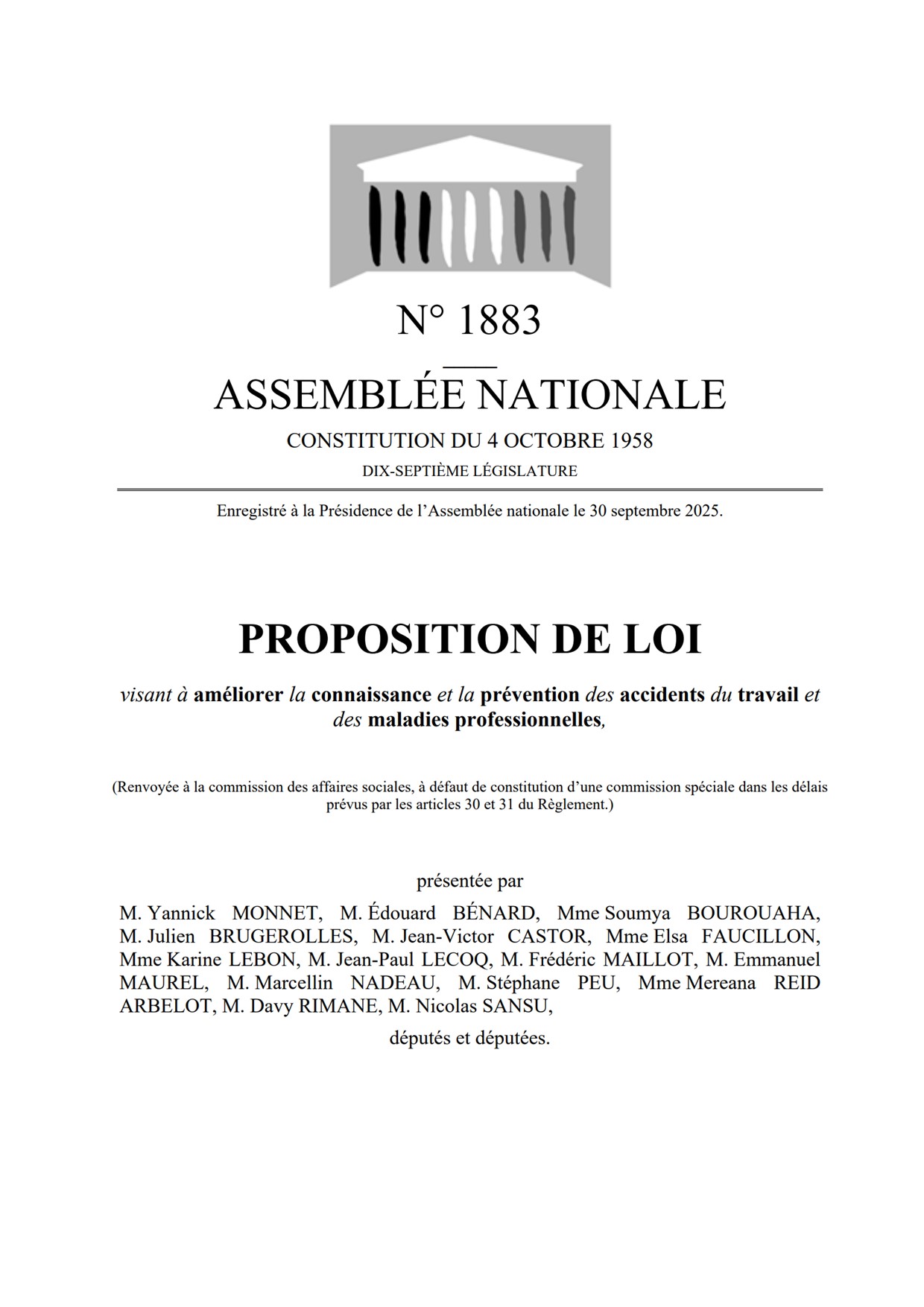La France figure parmi les pires « élèves », en Europe, au sujet des accidents du travail : plus d’un million d’accidents et de maladies professionnelles déclarés chaque année.
Des chiffres très partiels, puisqu’ils n’intègrent ni la Fonction Publique, ni les agriculteurs, ni les autoentrepreneurs… et ne tiennent évidemment pas compte des accidents et maladies non déclarés.
Cette « hécatombe invisible » doit être plus fermement combattue, et donc davantage connue et documentée. C’est indispensable à la prévention, à la reconnaissance et à la réparation des préjudices subis.
C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cette Proposition de loi « pour améliorer la connaissance et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
Dans cette Proposition de loi, je propose la mise en place, par la puissance publique, d’un outil statistique de recensement exhaustif des accidents du travail et maladies professionnelles, incluant l’ensemble des secteurs d’activité et faisant l’objet d’un rapport annuel. Je propose également le rétablissement des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dont la suppression, en 2017, a privé les représentants des salariés de pouvoirs d’intervention sur l’organisation du travail afin de favoriser une véritable culture de la prévention.
Je souhaite que ce texte puisse être rapidement inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée ; quoi qu’il en soit, nous la défendrons à l’occasion de la prochaine « niche parlementaire » du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine, au sein duquel je siège.
EXPOSE DES MOTIFS :
Mesdames, Messieurs,
En France, en 2023, l’Assurance maladie a recensé 1,03 million d’accidents du travail, d’accidents de trajet et de maladies professionnelles déclarés. Le nombre des seuls accidents du travail est évalué à 772 784 et a conduit à 759 décès, contre 738 un an plus tôt. Soit près de trois morts au travail par jour en moyenne ([1]).
A ce sinistre bilan, il convient d’ajouter 332 accidents de trajets mortels survenus entre le domicile et le lieu de travail (46 cas supplémentaires par rapport à 2022), et 196 décès consécutifs à une maladie professionnelle (7 cas de moins qu’en 2022).
Au final, ce sont donc 1 287 morts au travail, tous sinistres confondus, que l’on peut déplorer en 2023 (soit 60 décès en plus par rapport à 2022).
Ces données, accablantes, sont cependant loin de cerner l’ampleur du problème puisque la Caisse nationale d’assurance‑maladie ne recense que les salariés du régime général et n’intègre ni la fonction publique, ni les agriculteurs, ni les marins‑pêcheurs, ni la majorité des chefs d’entreprise ou encore les autoentrepreneurs. C’est ainsi qu’en 2023 la Mutualité sociale agricole (MSA) a dénombré 39 145 accidents du travail et maladies professionnelles, parmi lesquels 65 décès ([2]).
En outre, les accidents et les maladies liés au travail, non déclarés ou ceux déclarés mais non reconnus ([3]), demeurent invisibles puisqu’ils ne sont pas comptabilisés par l’Assurance maladie en tant que tels.
Ces accidents et maladies constituent une bonne part de « l’hécatombe invisible » ([4]) qui a pour traduction administrative la « sous‑déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ». En effet, depuis 1996, les lois de financement de la Sécurité sociale évaluent le montant annuel que la branche AT‑MP (accidents du travail‑maladies professionnelles) doit reverser à la branche « maladie » de la Sécurité sociale au titre des atteintes à la santé d’origine professionnelle mais considérées à tort comme relevant de la « maladie ». Cette logique institutionnalisée relève d’une aberration puisqu’elle convient d’une méconnaissance des dégradations et des risques au travail, sans toutefois en faire un enjeu de santé au travail, voire de santé publique. Avec le plus grand cynisme est ainsi également quantifié un certain nombre d’accidentés et de malades qui ne seront jamais reconnus dans le cadre des « AT/MP », et qui n’obtiendront donc jamais réparation au titre de ce préjudice causé par leur travail.
Par ailleurs, la publication du dernier rapport de l’Assurance maladie a laissé les organisations syndicales très perplexes face à un constat pour le moins troublant : le nombre total d’accidents du travail qui donne lieu à indemnisation recule depuis quelques années (– 100 000 entre 2019 et 2023), alors que celui des seuls accidents mortels s’accroît et que dans le même temps certains risques ne cessent d’augmenter tels que les risques psychosociaux et les troubles musculo‑squelettiques. Une telle évolution conforte l’idée que des déclarations de sinistres demeurent invisibles et que certains risques sont sous‑évalués.
Dans ce contexte, il apparaît qu’une connaissance exhaustive du nombre, de la fréquence et de la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, de leurs facteurs de causalité, des lieux et circonstances de leur survenue, est indispensable à leur prévention, à leur reconnaissance et à leur réparation.
D’ailleurs, face à cet angle mort de la connaissance statistique des accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier « Plan Santé au travail » de 2004 et l’article 15 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoyaient la mise en œuvre d’un « outil de centralisation et d’analyse statistique ». L’Institut national de veille sanitaire s’était ainsi vu confier la tâche de mettre « en œuvre, en liaison avec l’assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l’analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d’origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l’article L. 1413‑4 » ([5]). À cette fin, l’inspection générale interministérielle du secteur social (Igas) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) avaient été chargées de produire un rapport d’audit « de l’organisation du système d’information statistique relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles », un sujet déjà identifié à l’époque comme « sensible et récurrent » ([6]). L’ambition de ce nouvel outil de recensement et d’analyse était notamment de rendre la veille sanitaire plus efficiente, de mieux détecter les risques émergents afin de les prévenir efficacement.
Malheureusement, force est de constater que les précieuses recommandations de ce rapport sont demeurées sans suite avec, dans son sillage, la dissolution de l’Institut national de veille sanitaire décidée dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016.
Pourtant, les besoins en la matière ne se sont pas taris. Bien au contraire. Et la mise en œuvre d’un outil susceptible de recenser de manière la plus exhaustive possible les accidents du travail et les maladies professionnelles en vue d’en clarifier la cartographie générale est cependant une mesure simple, rationnelle et peu onéreuse.
C’est dans ce contexte que la présente proposition de loi, s’inspirant du travail conduit à l’époque par l’Igas et l’Insee, vise à mettre en œuvre un outil de recensement exhaustif en étendant le champ des statistiques relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à toutes les professions et à tous les secteurs d’activité, ainsi qu’à tous les organismes de sécurité sociale obligatoires ou spéciaux (article 1er). Les données ainsi collectées seraient centralisées par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) et feraient l’objet d’un rapport public annuel dans le cadre de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Ces données seraient, en outre, consultables notamment par les travailleurs, la médecine du travail et les corps de l’inspection du travail.
L’article 2 de la proposition de loi entend étendre aux travailleurs des plateformes, l’affiliation aux assurances sociales du régime général. Concrètement, il s’agit de mettre en œuvre la présomption de salariat sur la base des critères retenus dans le cadre de la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme ([7]). Selon une étude de la Dares, ces travailleurs, estimés à 600 000 en 2023, sont généralement sujets à des durées de travail variables, particulièrement élevées et avec davantage d’horaires atypiques. La Dares note également que leur travail est « plus intense », qu’« ils font face à des exigences émotionnelles plus fortes que les salariés et les autres indépendants ». Ainsi, 30 % de ces travailleurs déclaraient en 2023 un état de santé altéré et l’étude note que les infrapathologies (troubles du sommeil et douleurs fréquentes) apparaissent dans des proportions similaires à celles des salariés et des indépendants. Pourtant, faute de la mise en œuvre de la directive européenne relative à la présomption de salariat, l’ensemble de ces travailleurs ne sont pas pris en considération dans le recensement des accidents du travail et des maladies professionnelles et surtout, ces travailleurs ne bénéficient d’aucune reconnaissance et réparation au titre des maladies professionnelles et des accidents du travail par la Sécurité sociale, sauf à avoir souscrit à une assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles.
Par ailleurs, la suppression des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l’ordonnance n° 2017‑1718 du 20 décembre 2017, en dessaisissant les représentants du personnel d’une expertise ciblée et soutenue par des moyens ad hoc sur les problématiques de santé et sécurité au travail, a participé activement à la hausse des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais également à leur « invisibilisation » croissante. Désormais, seule subsiste l’obligation d’installer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique (CSE) dans les entreprises ou les établissements de plus de 300 salariés. Une étude de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires), justement intitulée « La santé au travail, grande perdante des ordonnances de 2017 », a récemment mesuré les conséquences des ordonnances travail de 2017 et a dressé un constat sans appel ([8]).
Au regard des constats accablants en matière d’accidents au travail et de maladies professionnelles, il apparaît aujourd’hui indispensable aux auteurs de la présente proposition de loi de redonner aux salariés et à leurs représentants des pouvoirs d’intervention sur l’organisation de travail pour favoriser une véritable culture de la prévention.
L’article 3 de la présente proposition de loi vise donc à rétablir les CHSCT supprimés par l’ordonnance relative à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise.
Dans l’idée de renforcer le rôle des représentants des salariés dans la prévention des risques et de favoriser la prise en compte des risques nouveaux liés à la santé environnementale, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit l’inscription, dans les thèmes de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), des arrêts de travail pour accidents et maladies professionnels, ainsi que les enjeux de santé publique et au travail découlant des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Il s’agit d’une préconisation formulée en 2023 par le Conseil économique social et environnemental (CESE) et qui revêt l’avantage de renforcer d’une part l’exigence de transparence due par l’entreprise sur ces questions et d’autre part la connaissance de ces problématiques pour les représentants des salariés.
Enfin, l’article 5 constitue le gage de la proposition de loi.