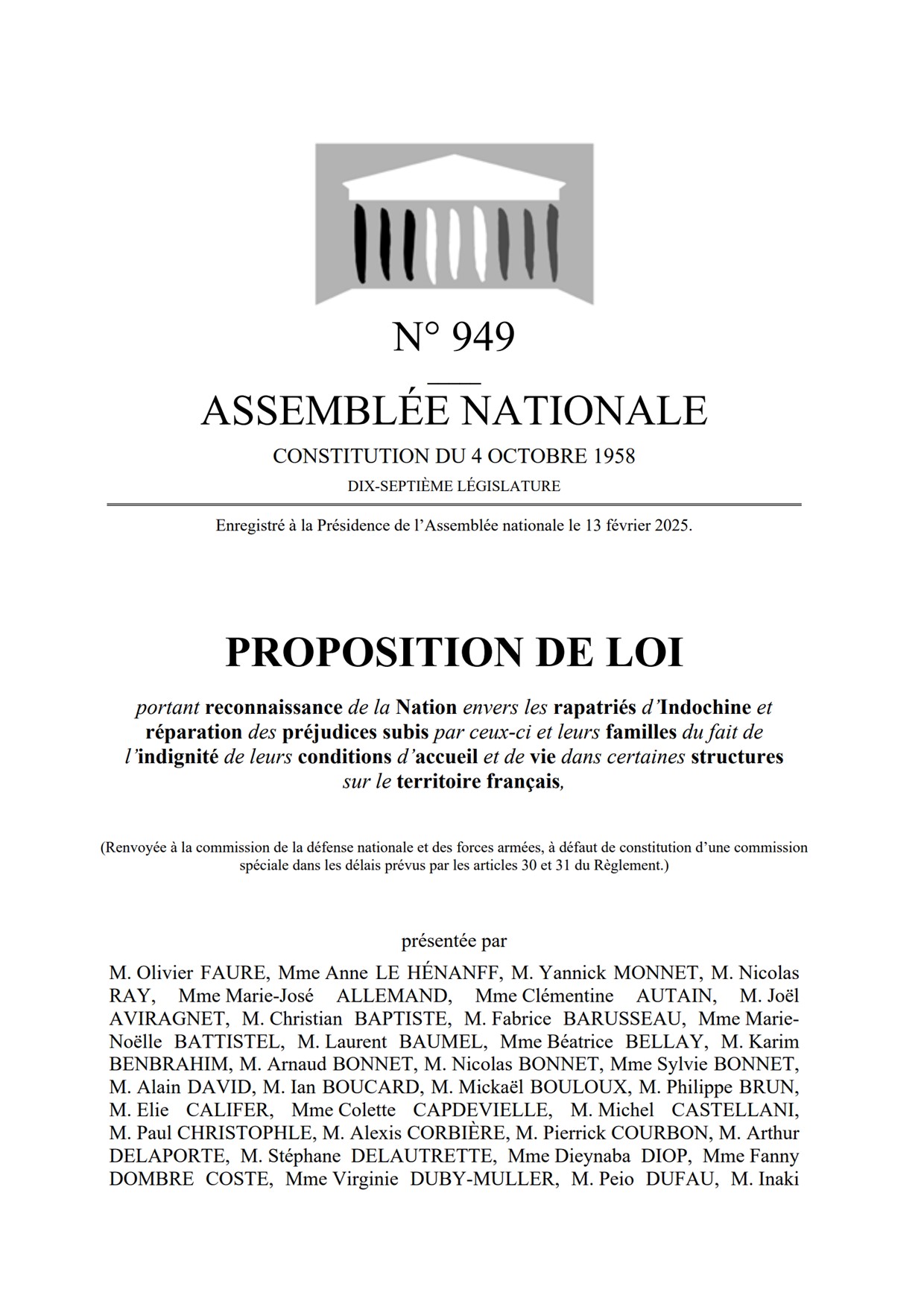Je suis le 3ème cosignataire de cette Proposition de loi, que j’ai travaillée notamment avec mon collègue Olivier FAURE en m’appuyant sur le vécu et les témoignages de l’Association des Rapatriés d’Indochine de Noyant d’Allier.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français a marqué une étape importante et attendue pour notre mémoire collective. La France a enfin reconnu sa responsabilité du fait des conditions indignes de l’accueil sur son territoire d’une partie de sa population, ayant entraîné privations, atteintes aux libertés individuelles, exclusion, souffrances et traumatismes durables. Cette étape nécessaire a toutefois laissé de côté nombre de nos compatriotes ayant subi le même sort : les « rapatriés d’Indochine ». À leur arrivée en France, les familles des rapatriés d’Indochine et les familles des harkis ont vécu dans les mêmes conditions, ont été administrées par les mêmes ministères et soumis dans les premières années au même arrêté Morlot, qui les privait de leurs droits et libertés. Ils ont rencontré les mêmes comportements méfiants venus de l’extérieur qui constituait un monde à part, impénétrable, même si les autorités locales de Noyant d’Allier se sont montrées engagées, logeant les rapatriés dans les corons laissés vides par la fermeture de la Mine. Ils ont connu les mêmes difficultés pour devenir des Français pleinement reconnus dans leurs droits, avec des douleurs souvent transmises d’une génération à l’autre. Cette proposition de loi a donc pour objectif de réparer une inégalité de traitement – ultime abandon et humiliation – et de faire bénéficier les rapatriés d’Indochine de la même reconnaissance et des mêmes réparations que celles accordées il y a 3 ans aux harkis.
Un rappel s’impose sur ce pan de notre Histoire contemporaine méconnu. Suite aux accords de Genève mettant un terme à la Guerre d’Indochine il y a tout juste 70 ans, 44 000 rapatriés civils furent accueillis entre 1954 et 1974 – quand 10 000 l’avaient déjà été entre 1945 et 1953. Peu après la chute de Dien Bien Phu, les Français emmenèrent avec eux leurs familles de nationalité française. Il s’agissait avant tout des compagnes vietnamiennes de soldats français ou de membres du corps expéditionnaire avec leurs enfants métisses, ainsi que des jeunes Vietnamiens engagés dans l’armée française. Certains avaient déjà vécu depuis deux années dans des camps de transit dans le Sud Vietnam, dans des conditions éprouvantes. Tous vécurent à leur arrivée un vrai déracinement mais aussi un déclassement social en arrivant dans l’Hexagone.
Environ 6 000 personnes furent accueillies dans des centres de transit, puis dans des camps à Sainte‑Livrade‑sur‑Lot et Bias dans le Lot‑et‑Garonne et dans les corons de Noyant d’Allier. Il n’y avait alors aucun cadre juridique institutionnel. Dans l’urgence, ces lieux d’accueil s’apparentèrent vite à des enclaves coloniales administrées militairement. L’arrêté Morlot de 1959 vint encadrer davantage leurs conditions de vie. Il était notamment interdit « tout signe extérieur de richesse » : à Sainte‑Livrade impossible par exemple de posséder une télévision ou une voiture pour aller travailler. Pas de chauffage. Pas d’invités extérieurs ni de sortie du camp sans autorisation parmi d’autres règles totalement injustifiables. Pour ces citoyens français, vivre dans ces centres revenait à être spolié de leurs droits fondamentaux.
Les habitants de ces camps durent s’habituer à vivre en autarcie, avec une quasi‑absence de services et d’aide publics. Les femmes, souvent seules, travaillèrent pour la plupart en étant sous‑payées et mal protégées, dans les champs alentour, avec comme point cardinal l’avenir de leurs enfants. Enfants qui restèrent pendant un an sans école, compliquant leur intégration et leur causant de réelles pertes de chances. Lorsque des demandes de prise en compte des difficultés sociales ou sanitaires furent exprimées, elles furent réprimées. Ainsi de la manifestation au camp de Bias en 1959. Des familles occupèrent le bureau du directeur. Cela se solda par des expulsions d’hommes loin de leurs familles et l’installation de trois escadrons de CRS pour encadrer le camp pendant trois mois, y compris dans le camp voisin de Sainte‑Livrade.
À la répression s’est ajoutée l’invisibilisation de ces populations par les pouvoirs publics lorsque la loi du 26 décembre 1961 donna une définition juridique aux rapatriés et mis en place des dispositifs d’assistance, de solidarité et d’aide à l’insertion en leur faveur. Le nom de « rapatriés d’Indochine » fut remplacé par celui de « Français d’Indochine » pour les priver du bénéfice de cette mesure et les CARI (Centre d’accueil des rapatriés d’Indochine) de Sainte‑Livrade et de Noyant d’Allier devinrent ainsi les CAFI (Centre d’accueil des français d’Indochine), l’État français considérant qu’ils avaient fui pour des raisons économiques et non politiques. Cette requalification venait aussi conforter un statut de Français à part, obtenu par le décret du 4 novembre 1928 qui concernait principalement des personnes issues de métissages. Le résultat de cette décision n’était pas que sémantique mais eut des conséquences pratiques : des conditions d’aide restrictives ou excluantes – les arrivés avant 1961 n’eurent ainsi pas accès à l’allocation de subsistance.
S’ensuivit une longue période où le sort de ces populations fut oublié, l’État comptant une intégration au fil de l’eau des générations suivantes. Quand la France se tourna enfin sur l’accueil de ses rapatriés, elle en oublia une importante partie. Ainsi, la version initiale de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ne mentionna pas les rapatriés d’Indochine. Leur mention ne fut ajoutée que par amendement au cours des débats. Ils se trouvèrent une nouvelle fois exclus des dispositions sociales garanties à certains harkis, telles que l’allocation de reconnaissance. Dans son rapport 2006‑110 de juillet 2006 sur la « mission sur l’extension des mesures de réparation existantes à l’égard des rapatriés du Maghreb à l’ensemble des rapatriés d’Indochine », l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) conclut que ces derniers « attendent légitimement de leur patrie une attitude de reconnaissance et de conservation mémorielle de leur propre histoire ». Mais aucune suite ne fut donnée depuis.
Ce n’est qu’en 2014, 60 ans après, que les dernières familles du camp de Sainte‑Livrade furent relogées. Depuis, leurs descendants des 2e et 3e générations réunis en association tentent de préserver cette mémoire en faisant des propositions d’utilisation des lieux, sans succès pour le moment. À Noyant d’Allier, un espace mémoriel est en cours de réflexion par la mairie, aidée des associations, mais sans les moyens financiers à la hauteur. L’adoption de ce texte participerait de la nécessaire prise de conscience collective, de la nécessité de préserver la mémoire de cet épisode de notre Histoire.
Il est significatif que la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis (CNIH) présidée par M. Jean‑Marie Bockel reconnaisse elle‑même cette rupture d’égalité. Dans son rapport d’activité de 2022, elle statue ainsi « La CNIH suggère que le périmètre de la loi du 23 février 2022 soit étendu aux anciens supplétifs et/ou rapatriés d’Indochine, afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes réparations que les anciens supplétifs rapatriés d’Algérie ». Dans une note de 2021, le chef du bureau central des rapatriés de l’office national d’anciens combattants et victimes de guerre estimait « entre 250 et 300 » le nombre de personnes encore vivantes concernées.
Les rapatriés d’Indochine furent les premiers rapatriés de l’histoire française. Ils demeurent les derniers oubliés du législateur français. Le sort qui leur fut réservé induit une sorte de sous‑citoyenneté française, bien loin de nos textes fondamentaux qui consacrent « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. » La présente proposition de loi propose de mettre un terme définitif à ces discriminations en accordant la reconnaissance de la Nation et en réparant les préjudices subis par les rapatriés d’Indochine du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil sur le territoire français.