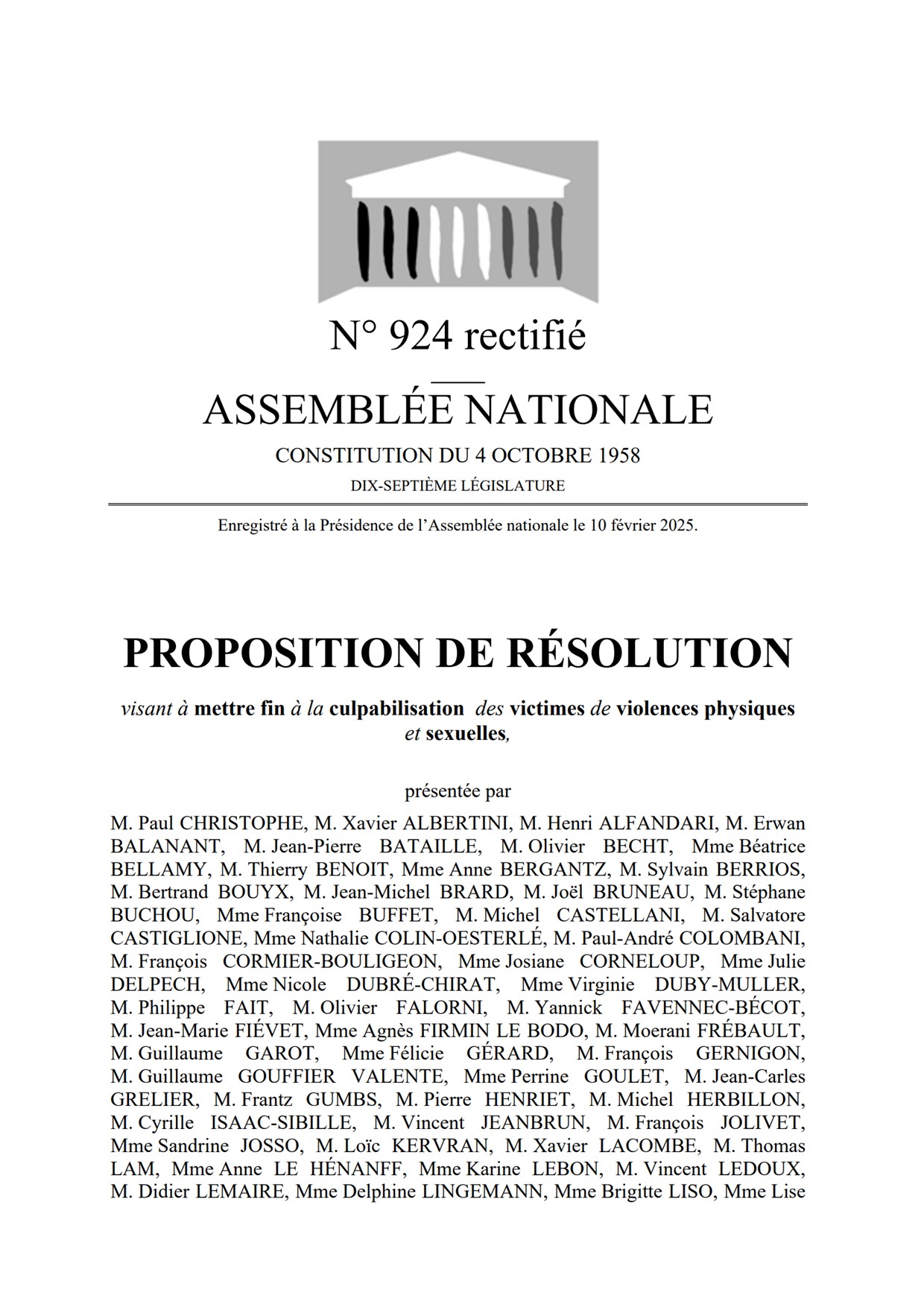EXPOSE DES MOTIFS
La date du 23 janvier 2025 marque définitivement un tournant historique dans notre conception du consentement et des droits individuels au sein du mariage.
Les journaux en parlent en ces termes : « C’est une première ! ».
Ce jour‑là, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) après avoir prononcé un divorce pour faute aux torts exclusifs d’une épouse, en raison de son refus d’entretenir des relations sexuelles avec son mari. Les juridictions françaises avaient précédemment prononcé, puis confirmé après appel et pourvoi en cassation, la décision du divorce de Mme W. pour non‑respect des obligations liées au « devoir conjugal ». Épuisant tous les recours nationaux, l’épouse blâmée s’était alors tournée vers la justice européenne, avec le soutien déterminé de très nombreuses associations.
Justice rendue, les avocates de la plaignante ont réagi avec force au verdict, interprété comme une victoire non seulement pour leur cliente, mais également pour toutes les femmes : « Désormais, le mariage n’est plus une servitude sexuelle. Cette décision est d’autant plus fondamentale que près d’un viol sur deux est commis par le conjoint ou le concubin. Les arrêts de la CEDH bénéficiant d’une autorité de la chose interprétée, la décision de ce jour va s’imposer aux juges français qui ne pourront plus considérer qu’une communauté de vie implique une communauté de lit. »
Cet arrêt met ainsi un terme à une incohérence majeure dans le droit français. En effet, malgré la reconnaissance du viol conjugal en France depuis le début des années 1990 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ([1]), des décisions nationales de justice civile continuaient d’instaurer une obligation sexuelle implicite dans le cadre du mariage.
Par ces jugements, les épouses – pour l’écrasante majorité des cas – étaient condamnées à verser des dommages et intérêts à leur ex‑conjoint.
Mais cette réminiscence du droit canonique allait surtout contre la liberté sexuelle de tous et le droit de chacun à disposer de son corps. À travers cette anomalie juridique, notre société imposait une violence systémique et psychologique d’une extrême gravité à ces femmes. Leur condamnation la plus préjudiciable se faisait alors discrète, presque silencieuse.
Cette oppression subtile, bien que non écrite dans notre code civil, pesait lourdement sur elles. Elles se retrouvaient prisonnières d’un rôle imposé par nos traditions obsolètes, en totale contradiction avec nos valeurs contemporaines et l’affirmation des droits individuels.
Répétons‑le autant qu’il le faudra : toute contrainte ou pression exercée pour obtenir des relations sexuelles constitue une atteinte grave à la dignité humaine.
Par cette décision bienvenue, la CEDH nous rappelle que le consentement ne peut en aucun cas être présumé d’office. Elle nous invite également à repenser et à réformer nos pratiques juridiques et nos conceptions sociales pour que celles‑ci correspondent davantage à la société que nous souhaitons bâtir ensemble.
La France, plus grande aujourd’hui qu’hier grâce à l’impressionnante Mme Gisèle Pelicot, doit effectivement réviser certaines de ses pratiques judiciaires.
En demandant la levée du huis clos du procès des viols de Mazan, celle que l’on surnomme désormais « le visage du courage » a embarqué toute notre société avec elle dans son combat contre les violences sexuelles.
Alors qu’elle ne sait pas encore « si le reste de sa vie lui suffira pour se relever » des traumatismes vécus, Mme Gisèle Pelicot n’a exprimé qu’un seul souhait tout au long du procès de ses bourreaux : que la culture du viol cesse.
Nous nous devons d’être à la hauteur de sa volonté.
Pour notre jeunesse, nous nous efforçons d’améliorer notre façon d’expliquer les fondamentaux d’une nation où l’égalité et la justice ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités tangibles pour toutes et tous.
Nous parlons à nos jeunes du consentement et des violences psychologiques, physiques et sexuelles dans l’espoir de les protéger et de produire une génération plus consciente et respectueuse des autres.
Parallèlement, des pratiques judiciaires persistantes viennent contrecarrer notre ambition de vivre dans une société plus juste et plus égalitaire.
Dans le monde des adultes, le passé sexuel d’une victime est encore scruté et sa moralité jugée à l’aune du nombre de ses partenaires ou de sa tenue vestimentaire le jour de son agression.
Comme si nous cherchions des circonstances atténuantes à l’accusé avant même que son procès n’ait débuté, nous venons nier et rendre illégitime la douleur de la plaignante. En focalisant l’enquête et le procès sur le passé sexuel de la victime, on lui laisse penser qu’elle serait plus ou moins digne de notre protection, qu’elle serait plus ou moins responsable des souffrances qu’un autre individu lui aurait fait subir.
En l’espace d’un instant, d’un regard ou d’un mot, la victime devient alors coupable de négligence aux yeux d’une société prompte à juger.
Ces postures conduisent à de nouvelles souffrances pour les victimes qui réclament justice et elles condamnent les autres au silence par peur d’être jugées. Si la formation des enquêteurs a certes été renforcée pour accueillir les plaignantes avec davantage de sensibilité et de respect, nous avons collectivement encore un long chemin à parcourir.
Cette transformation nécessite l’engagement de tous les acteurs de la société, des institutions publiques aux citoyens, afin de créer un cadre où la justice et la dignité humaine prévalent par‑dessus tout.
Alors que nous déplorons le très faible nombre de victimes de violences physiques et sexuelles qui osent franchir la porte d’un commissariat, il nous faut prendre conscience de la multitude d’obstacles qu’elles rencontrent pendant ce véritable parcours du combattant ainsi que des injonctions contradictoires que leur envoie notre société.
Autre paradoxe de notre siècle : lorsqu’une victime ne dépose pas plainte contre son conjoint violent, sa parole est durablement et injustement discréditée. Dans le même temps, de nombreuses plaintes ne sont toujours pas enregistrées en l’absence de marques visibles sur le corps et ce, en dépit de la clarification du droit français.
« La première fois, ses coups ont fait tourner au violet plus de la moitié de mon visage. La deuxième, je n’avais aucune marque. Alors, les policiers ont refusé de prendre ma plainte. Je suis revenue chez moi le soir même en me demandant si je devais espérer que la troisième raclée se voie. », déclare une femme victime de violences conjugales.
Combien de ces souffrances continuent d’être privées de justice, enterrées trop vite par des principes pourtant archaïques et désuets ?
Selon une enquête du ministère de l’Intérieur, un quart des femmes victimes de violences qui ne portent pas plainte estiment que les faits n’étaient pas suffisamment graves pour être condamnables.
N’est‑ce pas nous qui les avons convaincues de cela ?
Les mots sont le fondement de notre éducation et de notre culture. Ils préservent et transmettent nos valeurs les plus fondamentales. Mais parfois, ils viennent en dissonance avec un changement de mentalité dont ils n’ont pas encore pris la parfaite mesure.
Il nous revient alors de questionner leur usage et ce qu’ils disent de nous.
Par cette proposition de résolution, nous soutenons une nouvelle ère juridique assurant une meilleure considération de la victime et de sa parole ainsi que la préservation des droits de toutes les parties.
Nous défendons le respect de la dignité humaine et luttons contre la stigmatisation des victimes de violences physiques et sexuelles, afin de leur garantir l’aide et la justice qu’elles méritent.